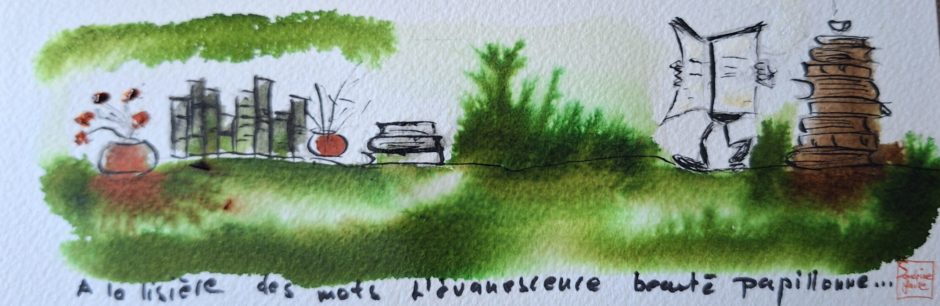Dans cet essai l’autrice, écrivaine et professeur d’université, spécialiste de la littérature du XVIII siècle, née en 1956, éclaire à contrepied du courant dominant les dictats parfois tacites, qui régissent les comportements des femmes en particulier, au sein de la famille, du couple et de la société.
L’ouvrage de Claude Habib à travers notre regard
J’ai découvert Claude Habib au hasard d’une émission radio !
Une voix féminine qui dit : « une femme seule, qui embellit son intérieur et une femme vivant en couple qui fait de même ne sont pas perçues de la même façon »…
Des mots qui éveillent mon attention en résonnant avec mes propres réflexions… J’écoute avec intérêt ses propos qui surprennent dans le flux du récit ambiant dominant !!
Sa réflexion est axée sur la mise en tension de privé et politique, intime et publique. Où sont les frontières, de quoi sont-elles faites, à quoi servent-elles, comment poser nos limites ?
Nous voici au cœur d’un questionnement qui m’habite !
Je fais aussi partie de la génération qui a salué et a bénéficié de l’avènement des idées féministes. Quand je suis née « se taire et obéir à son père, puis à son mari », c’était le destin de presque toutes les femmes. J’ai été persuadée, que de l’avoir compris tôt dans la vie, m’avais permis de me construire contre ces diktats!
Mettre en doute, questionner et désobéir si besoin, sont devenus mes verbes préférés !
J’ai grandi avec des femmes qui, poussées par la nécessité et puis plus tard par choix, n’ont pas hésité à s’imposer et à « mener leur barque » ! Elles ont été un modèle pour moi !
Néanmoins je me reconnais de moins en moins dans les prises de positions des féministes et je me demande où va nous mener le flux grandissant des revendications en tout genre/genre…
Je lis Claude Habib avec plaisir et beaucoup d’intérêt, son humour me touche, sa réflexion me convainc, elle pose un regard pointu. Son analyse de nos comportements, de notre obéissance aux nouveaux diktats ne nous épargne pas…
Son écrit s’articule en trois parties :
Les conditions de l’union
Cinq chapitres pour nous nous éclairer sur l’évolution du contexte socio-politique et un peu d’histoire pour nous guider dans sa réflexion :
-Travail et désinvestissement
-La formation des couples
-Qu’appelle-t-on privé
-Quelques conditions historiques
-Asymétrie des sexes, division des attentes
A partir du grand débat qui a entouré l’augmentation de l’âge de la retraite en France, qui a mis en exergue comme une opposition entre « vie vécue en famille et pendant les loisirs et vie perdue pendant le travail », l’autrice conclut : …comme si l’accomplissement de soi que permet le travail ne constituait plus une priorité, mais que seulement hors du travail on avait une chance d’être soi. (p. 10)
Vie Active/professionnelle // Vie passive/passionnelle, elle se demande si notre affairement dans la vie professionnelle n’aurait pas comme seul but la possibilité de s’offrir un temps d’aimer, de gagner le temps de vivre…
Elle nous rappelle que la réussite professionnelle nous permet l’affirmation personnelle et nous offre la considération des autres. Ce cercle est vertueux pour ceux qui le vivent et décrié par les laissés-pour-compte.
Serait-ce donc cette vie privée, vie de couple, vie de famille, qui se déroule derrière les murs et les rideaux de nos maisons, mais que désormais beaucoup partagent volontiers sur les réseaux sociaux, le théâtre des pires injustices de genre voir de tous les crimes du patriarcat ?
Dans ce cas on pourrait imaginer que seuls les couples homos ont une chance de construire une relation égalitaire…
Mais analyser les relations de couple à travers le prisme de la justice/injustice, qui aboutirait à importer la lutte de genre à la maison est-ce la bonne manière de procéder ?
Le coupable idéal semble être l’homme ordinaire, le mâle blanc c’est celui qui souffre le plus de discrimination … au mieux il serait porteur d’un sexisme bienveillant, au pire d’une virilité toxique…
L’autrice nous dit que le spectre de la guerre des sexes vient dérégler les relations hommes/femmes !
Le paramètre financier n’est plus un frein à l’indépendance des femmes. Elles ne sont plus, non plus, indispensables au quotidien des hommes pour leur savoir-faire domestique.
Il est fini le temps où seuls les riches rentiers pouvaient s’offrir le luxe de vivre libres et célibataires ! Les autres restant majoritairement au sein de leur famille d’origine.
Les tâches du care ont toujours été l’apanage des femmes, comme l’aspiration de créer un cadre pour rendre la vie non seulement possible, mais aussi bonne et agréable. La motivation des femmes est portée par l’envie de créer un foyer où ceux qu’elles aiment puissent vivre et s’épanouir dans un espace de confiance.
Scènes de la vie de famille
Cinq chapitres pour nous plonger au cœur de la vie quotidienne
des femmes :
- L’amère expérience de la division
- Diversité des familles
- Créer son foyer
- Le ménage
- Le foyer percé
Nous créons un foyer au plus près de nos aspirations en tenant compte de la réalité du contexte dans lequel nous évoluons… Nous pouvons choisir nos partenaires, nos amis, etc…, choisir de faire ou non des enfants, mais nous ne pouvons pas, les choisir !
En somme il faut oser se lancer avec la donne qu’on a reçue, dit l’autrice !
Toutes les études montrent que la majorité se marie dans sa propre classe sociale pour la reproduire biologiquement, mais l’expérience que chacun vit va être singulière. Dans une même classe sociale les familles et les maisons ne se ressemblent pas, entre nos murs se trouve notre espace de liberté et la manière de faire famille reste à inventer. Il est impossible de réduire la question à reproduire ou pas ce que nos mères ont fait ou le refuser en bloc !
Mais à quoi aspire la jeune fille d’aujourd’hui ? Comment se définit la jeune fille « normale » aujourd’hui ?
Si elle existe : Y-a-t-il une place pour la normalité qui est décriée par les mouvements féministes ?
Faut-il trouver une place en s’alignant du côté des « minorités victimes et opprimées » qui semblent être dans l’air du temps ? Une place dans l’acronyme LGBTQUIAA+ ?
La jeune fille qui ne se vit pas comme victime est-elle une collabo du patriarcat ?
Voici les questions que pose Claude Habib !
Il est sûr que l’amour nous rend tous individualistes, il n’y a rien de plus individualiste qu’une femme amoureuse, rien de plus motivant que l’élan de faire sa vie…
Cet élan emporte aussi celles qui pensent le couple comme une séquelle de la domination masculine…
La question va être, comment partager nos croyances au sein du couple ?
C. H. nous dit que les croyances constituent un blocage. Un bloc, qui finira par être emporté par le flot des émotions, il reste visible par moments mais n’a plus d’utilité !
En principe, la maison est le lieu du monde où règne l’affection…(p. 63)
Malgré l’éventail d’expériences relationnelles que nous pouvons vivre au sein de la famille, nos proches, même quand on coupe les liens, restent proches. Nous continuons de souffrir à travers eux comme d’une douleur fantôme.
Sachant que nous sommes tous capables de trahir et d’infliger des souffrances, la vie nous mène à découvrir notre face sombre, mais une rupture invalide-t-elle les bonnes choses vécues ?
Elle nous rappelle que nous pouvons aussi être déçus par nous-mêmes et devenir notre pire ennemi ! L’inconfort que cela occasionne est aussi une chance d’évoluer et de se laisser transformer par la vie ! Au cas échéant, l’autrice affirme que l’ennemi intérieur est le pire ennemi qui soit. Le monde est en ordre quand les ennemis sont loin. (p. 66)
En général quand on se met en ménage on s’organise et on répartit les tâches ménagères.
Les soins du ménage sont souvent considérés comme basses tâches et accomplies traditionnellement par les femmes.
Ces besognes qui vont être accomplies à l’abri des regards, les soins de base, qui résonnent avec le « care » pour moi soignante !
Tous ces soins qui permettent et soutiennent la vie et qui ne sont toujours pas assez valorisés !
On peut se demander si c’est la répartition ou la non-valorisation de ces tâches qui est discriminatoire…
Les femmes s’identifient à leur maison, elles vont être mal-à-l’aise quand des étrangers voient leur maison sale, elles peuvent ressentir de la honte. La même honte que nous ressentons quand nous-même ou nos proches sont pris en défaut…
Pour les siens une maman fera plus qu’assurer un lieu de vie convenable, elle œuvrera pour que le beau et le douillet, le confortable et chaleureux adviennent, quitte à occulter la « dure réalité », les difficultés qu’elle rencontre à joindre les deux bouts par exemple !
Les écrans sont omniprésents et nous permettent d’échapper virtuellement à la complexité de la vie commune, les robots conversationnels et l’IA viendront peut-être à bout des relations interpersonnelles !
Maintenant que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, le dernier terrain pour le combat des femmes est celui de la maison, résumé par la formule féministe, je cite : le privé est politique, qui fait des exaspérations domestiques un conflit de classe !
Les angles morts du féminisme
Cinq chapitres pour proposer des pistes et des regards pour donner du sens :
- Le privé n’est pas politique
- Le viol, les viols
- Qu’est-ce qu’un intérieur ?
- Justice et bonheur
- Sans défense
L’abolition de la frontière public/privé n’est pas sans nous rappeler les régimes totalitaires du vingtième siècle, en cela ils se distinguent des régimes tyranniques du passé, dans lesquels la maxime aurait pu être pour vivre heureux, vivons cachés. (ex. Montesquieu, Lettres persanes, despotisme oriental),
Dans les régimes totalitaires la délation est encouragée et saluée comme un acte héroïque au sein même des familles, ces régimes instaurent une police politique : plus aucun espace est sûr. (1984, George Orwel – La vie des autres, film allemand de FH Von Donnersmark – …). Je retiens cette différence mise en exergue et je partage son rejet d’un privé politisé !
Elle nous rappelle qu’à l’origine pour les féministes rendre le privé politique avait le mérite de lui donner une valeur et en faire un sujet d’intérêt !!
Nous savons que le monde politique est le lieu pour défendre ses opinions, ouvrir les débats ! Le monde privé a été celui de l’amour par opposition !
En démocratie, nous dit l’autrice, pas de solutions, mais des réglages et des compromis.
Mieux vaut un régime qui permet d’exprimer les tensions, qu’un qui les étouffe sous prétexte d’avoir résolu les différents une fois pour toutes ! Mais aujourd’hui les liens privés n’échappent plus au procès en domination…
La réponse à la question, comment des femmes averties ne se sont pas méfiées de la « dérive totalitaire » que constitue le regard politique sur la vie privée, est à mettre en lien avec les nombreuses perspectives que cela offre, nous dit C.H.. Toutes les victimes de la masculinité toxique gagnent à cette levée de rideau !
Grâce aux dénonciations féministes la parole a pu se libérer et les violences faites aux femmes sont vues aujourd’hui comme inacceptables.
C’est en 1990 que la première condamnation pour viol au sein du mariage est prononcée en France !!
Elle nous fait remarquer avec humour, citant auteurs et fait divers, qu’il y aura toujours quelques irréductibles pour remercier Dieu d’être nés hommes, mais que dans nos sociétés occidentales les principes d’égalité de droits entre les sexes sont désormais admis par tous…
La politisation du privé, telle que les nouvelles féministes la préconisent, ne vient pas de l’extérieur, mais nait au sein de nos liens familiaux et intimes, nous dit C.H. et cite de nombreuses essayistes et écrivaines féministes.
Leur but n’est pas de détruire les liens, mais de mettre en évidence le gâchis des liens de pouvoir préexistants qui entravent l’épanouissement des femmes…
Elle pose la question : faut-il supprimer les couples hétéros et les familles pour éradiquer les inégalités ??
Certaines féministes hétérosexuelles en couple avec des hommes fidèles et fiables sur le long terme parlent de nouvelles familles et d’hommes déconstruits : rien de plus qu’une version revisitée de wokisme des attentes ordinaires, affirme l’autrice !
Les féministes radicales lesbiennes dénoncent, quant à elles, l’inévitable compromission des hétérosexuelles et les familles classiques sont accusées de perpétuer la domination masculine !
… une fois posé que les femmes sont les perdantes de la vie de famille, les hommes ont un profil de coupable idéal et tout est dit. (p. 117)
La réflexion de C.H. est étayée par des références scientifiques et littéraires, la sagesse populaire vient aussi nous éclairer.
La littérature nous aide à percevoir, distinguer, nommer les sentiments en nous faisant prendre du recul. Elle nous offre la possibilité d’éprouver d’autres points de vue. Le discours féministe, discrédite le langage des passions et prône le chemin des faits ; du vécu individuel vers l’universel où comment enrôler la détresse singulière dans le malheur global !
Elle regrette la disparition de la notion même de crime passionnel… Alors que selon elle, il faudrait distinguer entre crime passionnel et crime sociétal.
Elle raconte Maïwen qui a mis en scène « La Du Barry, de prostituée à maitresse d’un roi, p120
Ce que le film suggère est qu’il n’y a pas à choisir entre la pente douce de la séduction et le dur chemin de l’autonomie, … alors qu’un féminisme étroit professe que le désir de plaire est un renoncement à l’ambition personnelle…
J’apprends l’existence du SCUM Manifesto de Valerie Solanas, intellectuelle, écrivaine féministe radicale et queer, (Society for cutting of men, en français société pour la castration des hommes…) (p. 125)
Et celle des « colleuses », collectif féministe qui se charge d’afficher et réactualiser le nombre de féminicides à ce jour depuis le 1er janvier.
Selon l’autrice, faire du malheur individuel des victimes un fait de société mène à polariser le débat dans les cas de féminicide. Ce même mécanisme est en œuvre aussi dans les viols, dont la définition ne cesse de s’étendre. Elle expose et analyse les processus qui mènent à cette polarisation regrettable qui aboutit à supprime la notion même de débat !
Dans certains pays de l’UE le viol a été redéfini comme : acte sexuel qui n’est pas précédé par un consentement explicite, la condamnation emblématique qui en découle est celle de J. Assange en Suède qui est annulée par la suite, faute de preuves… Nous en sommes tjrs à confronter la parole de l’un et celle de l’autre. Pour qu’un consentement ait une portée juridique il faudrait qu’il soit vérifiable… Conclut C.H.
La confrontation de points de vue reste vive autour de la responsabilité des uns et des autres dans les rangs féministes et non ! Je voudrais vous citer tous ces points de vue, tous me paraissent pertinents pour enrichir le débat.
Je repense à nos préparations en stage en psychiatrie et à nos mises en garde quant à l’ambiguïté des attitudes et des tenues vestimentaires qui peuvent mettre en danger !!
Alors, est-ce que les filles peuvent ignorer le désir qu’elles sont capables de susciter ? Est-ce au désir masculin de s’effacer ??
Elle ne croit en aucun cas qu’il existe « une culture du viol », et développe arguments et contre-arguments, mais l’envisager, dit-elle, permet au moins d’imaginer qu’on peut en changer ! Elle cite Frans de Wall primatologue néerlandais, dans « Les genres vus par un primatologue, 2022 ». Il a observé que dans tous les groupes sociaux les mâles sont plus forts physiquement et plus enclins à la violence que les femelles, et a dit : Chaque société doit faire face à cette double réalité et parvenir à civiliser ses fils. (p. 146)
L’asymétrie des positions sexuelles est une évidence ! Selon l’autrice, la jeune-fille qui revendique le droit d’être soûle aussi bien que les garçons elle signifie qu’elle n’admet pas cette asymétrie !
Il semblerait qu’en France plus que la moitié des garçons et moins d’un tier des filles de douze ans ont fréquenté des sites pour adultes, avec quelle image de la sexualité rentrent-t-ils dans l’adolescence et quelle répercussion sur leur vie relationnelle, sur leurs attentes, sur l’augmentation des demandes de changement de sexe ?
Parmi les nombreux auteurs cités, essayistes, romanciers, chercheurs je vous partage ces mots de M. Agueev, écrivain russe, dans Roman avec cocaïne, 1990, qui résument si bien le vécu des uns et des autres : « Pour un homme amoureux toutes les femmes ne sont que des femmes, à l’exception de celle qu’il aime – elle est pour lui un être humain.
Pour une femme amoureuse, tous les hommes ne sont que des êtres humains, à l’exception de celui qu’elle aime. Pour elle c’est un homme. »
Dans nos maisons à l’abri des regards, dans nos familles nous faisons l’expérience d’une « formation holistique ». C.H. nous demande que deviendrait le monde si toutes les tâches accomplies pour autrui, souvent par les mères, deviendraient tarifées ? Des études en ont quantifié le coût !
Si nous suivons la logique féministe ce travail constitue une énorme contrainte pour les femmes qui les entrave dans leur épanouissement… Celle qui choisissent cette voie le font par ignorance, peur, etc. Prisonnières de cette situation dans une famille où elles deviennent corvéables à souhait une seule issue s’offre à elles: devenir une souillon ou une furie !
La rhétorique qui précède cette conclusion triviale, résonne en moi…
Je ne compte plus nos discussions parfois houleuses et mes tentatives récurrentes de persuader les miens de l’importance et de la valeur du travail de l’ombre qui soutient la vie.
Selon le point de vue des féministes, pas de bonheur sans justice, donc l’égalité est le préalable à toute vie de couple heureuse…
Comme Sharone Omanisoy, cité par M. Mazaurette dans Le Temps du 14.02.22 (p. 169), la maison est considérée comme un lieu où adviennent des microagressions emblématiques qui justifient d’y importer la lutte.
Sachant que le but du couple est le bonheur et celui de la société la justice, cette manière de voir « est contraire à la paix dans la maison » parce qu’elle y importe les conflits. Elle ne tient pas compte que le DEDANS n’est pas égal au DEHORS.
Cette séparation permet la création et la survie d’un INTERIEUR.
La vie privée s’y déroule à l’abri des regards, moins importante que la vie publique, elle est le lieu des propos plus relâchés, des rires, des discours inconsidérés à partager qu’avec les intimes… Il y a dans les jardins des bosquets, plein de pépiements qui deviennent muets dès qu’un passant s’approche. (p. 181)
Elle nous dit que respecter la vie privée c’est reconnaître l’importance de ce qui n’est pas important, mais sans lequel la vie s’éviderait…
En conclusion elle nous propose une analyse de l’état social en France, avec les prises de positions et les arguments de la droite et de la gauche. Elle passe en revue les multiples raisons invoquées comme causes de la chute de la natalité dans nos pays d’occident.
Selon elle, le seul le but de l’état devrait être de soutenir l’envie de maternité en faisant en sorte qu’ en rien elle puisse constituer un handicap pour la femme ! Elle fait référence à la carrière professionnelle, à la perte de revenu, à la difficulté de trouver des places en crèche, un logement adapté abordable, …
Elle parle d’effort social en faveur des mères, des jeunes, comme du seul moyen pour marquer le besoin vital que la nation à d’eux. (p. 197)
Ne partage pas du tout, les discours qui mettent en avant l’hédonisme des jeunes femmes, mais pense que leur stress est grand face aux décisions qui engagent une responsabilité à vie. Par le passé, avant la contraception à la portée de toutes, l’état n’avait pas besoin de se préoccuper de la natalité, de nos jours il pourrait s’atteler à éliminer les obstacles qui se dressent sur le chemin de celles qui auraient envie d’enfanter, mais que le contexte retient !!
Luisella Congiu Mertel, janvier 2025
Habib, Claude. (2024). Le privé n’est pas politique. Gallimard