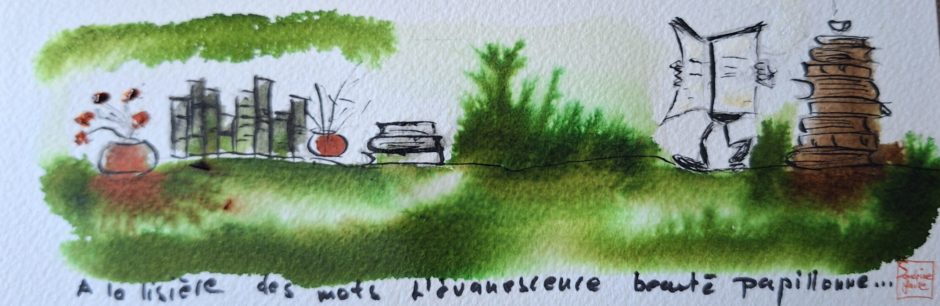L’ouvrage « Oser pleurer » est articulé en deux parties : pleurs solitaires et pleurs solidaires. Guillaume Le Blanc inaugure son livre par le récit de la perte de sa mère, qui l’a tant fait pleurer des mois et des mois « pas un seul jour où je n’ai pleuré » jusqu’à se sentir l’otage de ses pleurs.
A partir cet évènement personnel, l’auteur va s’interroger sur le sens des pleurs. C’est un aspect personnel évoqué par l’utilisation du « je » et l’ambition du livre pourrait être le sens des pleurs.
L’ouvrage de Guillaume Le Blanc à travers notre regard
Il part du postulat, non pas pourquoi on pleure mais pourquoi on ne pleure pas aussi souvent que l’on devrait ? serait-ce un aveu de faiblesse ? Pourquoi s’interdit-on cet acte inconvenant devant les autres ?
Les pleurs solitaires
Les pleurs sont une sécrétion physiologique qui engendrent un déséquilibre de notre homéostasie : ça se voit, on les montre qu’on le veuille ou non.
Il y a une audace à pleurer, les larmes s’imposent à soi. On pleure lorsqu’un être aimé meurt, c’est avouer et s’avouer que quelque chose ne passe pas. Si on se laisse aller à pleurer, on demande de l’attention, de la consolation et même de la réparation.
Nous pleurons dans des régions de notre monde personnel : là où nous avons mal physiquement et métaphysiquement ; on discerne la nature du mal ; on vit l’épreuve de la rupture et de la perte.
On prend le risque de se désagréger, personne d’autre ne peut pleurer à notre place.
Les pleurs ont été confisqués aux hommes (genre) au XIXe siècle, comme si cet épanchement leur ôte leur virilité, au profit de l’hystérie des femmes. Se référer à l’histoire sociale du corps dans le genre.
Freud parle de l’impossible état de la consolation qu’est la mélancolie.
La perte et la disparition
On associe les pleurs à la perte, inconsolation lors de décès car la perte est irrémédiable, définitive. Ce qui est perdu ne peut être remplacé, ainsi G. Le Blanc parle de la perte de la perte. L’impossible perte me renvoie à l’incomplétude de ma vie désormais.
Une présence indispensable à notre vie nous est ôtée, voilà qu’il faut vivre dans un état d’incomplétude et d’hébétude avec cette présence désormais disparue.
La perte entraine les larmes irrépressibles, la disparition entraine les pleurs qui eux affectent la vie. La perte signifie que ce qui est perdu est irremplaçable.
Pleurs suscités par la perte qui signifie la fin du monde et les pleurs liés à la disparition perdurent des mois plus tard. Les premiers sont un effet de la perte, les seconds constituent ce passage de la perte en disparition.
La perte se transforme en disparition.
La perte fait larmes mais tout, dans l’après coup de la disparition peut faire pleurs.
Dans l’épreuve de la perte, le survivant se consume et se perd dans les larmes, la disparition est une recomposition de la vie avec les pleurs.
Les pleurs ne se contentent pas de faire ressurgir le disparu, ils maintiennent sa présence par-delà l’absence et c’est précisément en quoi consiste l’essence de la disparition (plusieurs mois).
La perte est une épreuve physique : quelqu’un m’est arraché violemment. La disparition est une épreuve psychique : quelqu’un n’en finit pas de rester présent dans l’absence.
Les rituels de deuil rendent raison de cette perte ; la nécessité d’accepter la mort du mort.
Lors de disparition, je ne peux vivre sans le disparu, les pleurs apparaissent après, ce qui est disparu ne réapparaitra pas. La disparition est la perte en tant qu’elle ne passe pas et n’en finit pas de ne pas passer. C’est la reconnaissance a posteriori de ce qui est perdu et ne pourra jamais réapparaître.
Le disparu est présent alors qu’il est absent, les pleurs nous offrent une capacité de dialogue avec le disparu.
Les pleurs sont au-delà des larmes
Les pleurs maintiennent la présence du disparu au-delà de l’absence.
Les larmes qui nous envahissent lors de rupture, rupture entre ce qui a été, est et sera, le chaos engendré nous submerge, elles sont une marque extérieure de ce qui nous traverse, nous coupe de notre intérieur.
Même si on pleure de joie, d’une émotion, on pleure le plus souvent parce qu’on a mal, et l’immédiateté des pleurs, leur imprévisibilité mettent à jour notre fragilité, notre douleur. Mal de la perte inconsolable, de la disparition intolérable.
La plainte est plus vaste que soi. C’est une narration qui fait entrer le manque dans la psyché, repenser à sa vie interdite, sa jeunesse, sa santé perdue.
La plainte vise un tort qui est ressenti comme une injustice, les pleurs vont interrompre cette plainte, lamentation.
Pleurer, implorer, déplorer
Ontologie des pleurs
Pleurer est une puissance qui est un impouvoir : le pouvoir de ne pas pouvoir. Etre infiniment triste, la perte étant l’épreuve ultime de la tristesse. Les pleurs nous forcent à comprendre que nous ne sommes pas toujours maîtres de nos vies
Distinguons fragilité et vulnérabilité qui entrent en jeu dans nos larmes.
La vulnérabilité a été reprise dans les situations sociales, voire politiques ; c’est l’exposition à une blessure mais il faut s’activer pour y remédier (chercher du travail, guérir d’une maladie…).
La vulnérabilité renvoie à une potentialité avec une capacité à y répondre tandis que la fragilité suggère la vie non souveraine.
La fragilité laisse apparaître des limites, des limites de soi et les larmes nous amènent à la fragilité, on est défait par l’épreuve à l’origine des larmes.
Aussi les larmes peuvent être désir de renaissance, transcendent le passé, envisagent le futur, acceptent ou pas le présent même si la douleur est là. On sort de sa mécanique de protection.
Par les pleurs nous sommes seuls, contrairement au rire, esseulés, une solitude non voulue.
Réapprendre à pleurer c’est maintenir l’humanité du disparu dans l’humanité des vivants et ainsi se sentir soi-même pleinement humain.
On peut alors imaginer faire revenir le disparu et ainsi abolir sa disparition.
GLB insiste sur le signe vers l’avenir que porte les larmes, elles ne sont pas seulement ressassement, ou la seule déploration d’une perte. Les pleurs portent la promesse d’un futur, ils supplient que le mal qui les a provoqués n’ait plus lieu et qu’advienne un monde meilleur.
L’auteur décrit, après Georges Didi-Huberman, l’émouvoir comme une circulation des émotions, la possibilité d’être affecté à plusieurs, de constituer dans un espace-temps une communauté des émus, « des ouvroirs d’émotions potentielles », être au plus près de soi dans la pénombre, la dimension rédemptrice des pleurs.
Les pleurs nous retiennent, nous ancrent dans l’humanité. L’intimité nécessaire pour pleurer, avoir une chambre à soi comme le dit V.Woolf, ne pas se montrer. Les pleurs confirment l’humanité de celui qui est pleuré.
Et les larmes de crocodile ? si tu veux toucher quelqu’un il faut feindre de pleurer ; comme exemples, au tribunal, un enfant devant des maîtres, même des hommes politiques.
Les pleurs solidaires
Pleurer, implorer, déplorer
On retrouve dans cette deuxième partie les mêmes concepts que dans les pleurs solitaires. C’est une demande implicite ou explicite que mon chagrin, ma douleur cessent.
Déplorer, s’affliger, se plaindre. La déploration est une plainte constante, lamentatoire, ressassement, persistance jusqu’à épuisement.
Implorer, demander de nouveau que l’on voit les pleurs et qu’ils s’arrêtent.
L’imploration s’adresse publiquement, le cri, la clameur, une demande de reconnaissance de l’injustice. Les pleurs implorent, c’est transformer ses pleurs en demande de justice, demander réparation, l’imploration n’est pas résignation.
L’imploration est une demande par les pleurs, de nature humaine alors que la supplication (prière) est divine.
Transformer le réel depuis les larmes, ouverture à un futur de la réparation. Les pleurs prennent une dimension politique qui rend difficile la hiérarchisation des souffrances.
Est-ce que l’on serait alors devant une demande de réparation ? comment ressusciter la valeur d’une existence ?
Pleurer c’est attester dans son corps combien la perte est irréparable : l’irremplaçable d’une existence est à jamais perdue dans la perte. C’est pourquoi la valeur d’une vie tient à la capacité de pouvoir la pleurer ; une vie aura compté car elle aura été pleurée.
Quelles vies ne sont pas pleurées ? est-ce que le génocide du Rwanda a tant fait pleurer que les attentats du 11 septembre à New York ? (Judith Butler)………. est-ce que les vies ont toutes la même valeur ?
On pleure en solidaire devant des images, des photos de guerre (Syrie, Ukraine…) elles restent dans nos mémoires collectives, le rôle de ces images est aussi de ne pas nous faire oublier, on voudrait dénoncer, se révolter, quelques larmes peuvent couler aussi face à notre impuissance. Alors on pleure aussi pour les autres.
On ne masque pas nos larmes, mais cette expression d’un émoi est encore une spécificité féminine.
Aux femmes les pleurs, aux hommes la masculinité qui les réprime. La contagion des larmes traverse le corps des femmes, fait assemblée. Pourtant les deux ont mal, les autres nous ont fait du mal, les hommes, les femmes se sont fait mal entre eux, on se révolte devant une situation de vie et le sentiment d’injustice est si violent que les larmes sont la première révolte.
Les femmes de la place de Mai en Argentine pleurent et font politique.
Guillaume Le Blanc parle de dissentir, le contraire de consentir, devant l’intolérable.
On passe des pleurs privés aux pleurs publics, on restitue le nom et l’histoire du disparu. Le sociologue Luc Boltanski parle de double disparition, comme nous avons un double engendrement par la chair (la naissance) et par le verbe (le nom).
On pleure aussi devant la souffrance des autres, la compassion, ce sentiment qui nous emmène dans la souffrance de l’autre. Il peut être, dès lors ; de l’ordre du devoir de montrer sa peine, devant les guerres, les attentats, là où les pleurs solitaires deviennent solidaires. Même si il n’y a pas égalité devant ce que l’on voit des souffrances humaines.
Les larmes publiques de Obama attestent de son humanité. Si on ne peut douter de son authenticité, l’époque peut dériver dans un marché des larmes, jouer sur les émotions des citoyens. En cela, les hommes politiques l’ont bien compris et savent manipuler ce marché des émotions.
Il existe le risque de la déshumanisation si une mort ne donne lieu à aucun deuil. J. Butler (5) écrit « … il nous faut élargir notre conception des personnes dignes d’être pleurées, afin que notre deuil ne se fonde pas uniquement sur des identifications établies ; Tant que nous n’aurons pas appris que les autres vies méritent également d’être pleurées… je ne suis pas certaine que nous soyons vraiment en passe de surmonter le problème de la déshumanisation ». par conséquent faire deuil public de n’importe qui et pleurer pour tous les autres, les vies lointaines, à Kaboul, Téhéran, …. nous emporte vers la contagion des larmes où nous pleurons les uns avec les autres.
Parfois l’être humain est au-delà des pleurs, il est asséché (dans les camps, les otages…), c’est comme se protéger de la douleur ressentie, ne pas la voir, que reste-t-il de l’humain au-delà des pleurs ? Que deviendrons nous sans pleurer ? l’espérance de voir cesser nos larmes nous porte vers l’avenir.
Les nombreux philosophes cités enrichissent la pensée de l’auteur ; il est cependant impossible de les faire apparaître et ne serait-ce que présenter leurs propos dans ce texte, forcément réducteur. Sont nommés G. Deleuze, Pascal, C. Marin, Nietzsche, Spinoza, Rousseau.
La difficulté majeure a été donc de tirer les concepts signifiants d’après moi et d’opérer des choix.
Il fait aussi référence aux mythes antiques (Achille…) et aborde l’émotion artistique qui suscite les pleurs, mais la joie dans les larmes a été très peu présente.
Il est nécessaire et cependant nouveau de se plonger dans l’univers si peu exploré des larmes, de leur sens, de la fragilité momentanée de ces moments, d’en esquisser leur origine et leur devenir. L’auteur y apporte son regard complexe, parfois contradictoire aussi, d’une approche à la fois émotionnelle, intime, sociale et politique qui éclaire le sens de nos pleurs.
Faire sens sur cette expression si privée de son chagrin, de sa peine, l’accepter pour soi mais accepter d’offrir au monde cette audace des larmes permet d’entrer, de progresser dans son chagrin, d’en voir une issue, d’en reconnaître l’injustice, d’aborder l’intolérable et ses rives incertaines et d’entrevoir un potentiel émotionnel peut-être salvateur.
L’auteur se risque à penser que le chagrin peut être consolé, soutenu, soigné et que les larmes vont aider à la réparation, si on sait les voir, les recevoir, les partager, et ne pas que les interdire. Donc si on ose pleurer.
Yolande Meynet, avril 2025
- 1.G. Didi-Huberman, Peuples en larmes, peuples en armes, Paris, Les Editions de minuit, 2016
- 2. G. Didi-Huberman, Brouillards de peine et de désir, Paris, Editions de minuit, 2023
- 3. L. Boltanski. La condition fœtale. Une sociologie de l’avortement et de l’engendrement Gallimard, 2004
- 4. J. Butler, Antigone. La parenté entre vie et mort. Paris, Epel, 2003
- 5. J. Butler, Humain, inhumain. Le travail critique des normes, Paris, Editions Amsterdam, 2005, p.86
- 6. Claire Marin, Ruptures, Paris, Editions de l’Observatoire, 2019
Guillaume Le Blanc termine son ouvrage avec cette histoire sur les éléphants du Sri Lanka en 2005 ; histoire qui rend compte de l’hypersensibilité des pachydermes aux bruits avant-coureurs du séisme.
On raconte que, lors du tsunami de 2005 qui a dévasté le Sri Lanka, les éléphants ont pleuré peu de temps avant la catastrophe. Aucun d’eux n’est mort dans la plus grande réserve naturelle de l’île tandis que des dizaines de milliers d’humains ont tragiquement disparu. Sans doute ces pleurs ont-ils été provoqués physiologiquement par une réaction sans équivalent aux bruits de la catastrophe en raison d’une sensibilité extrême aux ondes sonores…
Alors que nous prêtons aux crocodiles les larmes fictives de l’animal qui souhaite attendrir sa future proie pour mieux la dévorer, nous avons désappris les pleurs de l’éléphant au point que nous n’avons pu les percevoir comme les signes du drame à venir (p.248).
Le Blanc, Guillaume (2024). Oser pleurer. Albin Michel.