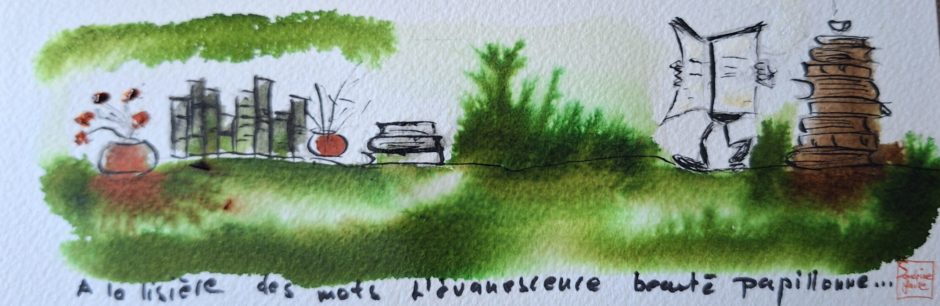Pour un aventurier, tout commence par l’étonnement, le dérangement voire l’émerveillement écrit Erling Kagge.
Le récit de Kagge est « une réflexion en promenade ». Son propos ne vend rien, ne conseille rien. Il n’est pas une leçon, juste une invitation à penser notre rapport au silence à l’aide de son expérience et de quelques pensées philosophiques. C’est un récit intime, pudique. Un pas à pas vers soi-même.
L’ouvrage d’Erling Kagge à travers notre regard
Cet essai commence par trois questions que des étudiantes et étudiants ont posées à Erling Kagge, lors d’une conférence qu’il a donnée à l’université de St Andrews en Ecosse sur le thème du silence.
- Pourquoi le silence est plus important que jamais ?
- Qu’est-ce que le silence ?
- Où est-il ?
Ces trois questions l’ont bousculé ; elles lui ont fait prendre conscience à quel point sa compréhension du silence était limitée. Il a retourné ces trois questions dans tous les sens. Il s’est mis à y réfléchir de manière passionnée, et il a commencé à écrire.
Pourquoi le silence est plus important que jamais ?
L’Antarctique est l’endroit le plus silencieux qui m’a a été donné de traverser nous dit Kagge. Sur la glace, très loin au cœur de ce néant blanc, immense, je pouvais à la fois entendre et sentir le silence. Chaque fois que je marquais une pause et qu’il n’y avait pas de vent, je faisais l’expérience d’un silence assourdissant. Même la neige paraît silencieuse quand il n’y a pas de souffle de vent. Je suis devenu de plus en plus attentif au monde dont je faisais partie. Parce que mes sens n’étaient pas émoussés et parce que rien ne venait me déranger. J’étais seul avec mes idées et mes pensées. Le monde disparaît comme vous vous fondez en lui, affirmait le philosophe Heidegger. C’était exactement ce qui se passait pour lui.
Qu’est-ce que le silence ?
Pour moi, nous dit l’auteur ; le silence est rarement gênant. Le silence m’apaise, me permet de mieux voir, de mieux entendre, de mieux sentir, ressentir, et de mieux me connaître. Dans le brouhaha je me perds. Pour moi, le silence n’est pas rien. Il est une force qui nous enrichit, un allié, et peut même être un ami. Le silence est davantage une qualité et une démarche (dé-marche) enrichissante plus qu’un état : une clé qui peut ouvrir la porte à de nouveaux modes de pensée .
Le silence n’a pas de dimension spirituelle ou celle d’une privation, c’est tout simplement un moyen pratique d’avoir une vie plus riche, mais le silence peut aussi faire peur et nous donner l’impression d’être exclu : le silence comme signe de solitude, ou de chagrin ».
Le déplaisir que l’on peut ressentir à être seul, à ne pas parler et à faire l’expérience du silence existait déjà au temps de Pascal qui exprimait que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos, dans une chambre. Nous le savons, l’intranquillité que nous ressentons, accompagne chacun de nous au cours du temps, mais c’est un état de fait !
Le présent nous tourmente et notre manière de lutter contre cela est pour certains de trouver des activités et, si possible, toujours nouvelles, qui accaparent notre attention et nous éloignent de nous-même. Par exemple, pour l’écrivain David Fosser Wallace, la félicité se trouve à l’opposé de l’ennui et il faudrait donc être unborable, inennuyable, c’est-à-dire sortir toujours du routinier, de l’insignifiant, du répétitif. Alors que pour d’autres, comme pour Kagge, l’occasion de s’ennuyer est intéressante. S’arrêter. Ne pas se connecter et s’interroger sur ce que l’on fait est vraiment nécessaire.
L’auteur nous informe cependant que des recherches montrent qu’être seul avec ses pensées pendant un quart d’heure est apparemment si insupportable que cela a poussé de nombreux participants à se faire envoyer une décharge électrique pour échapper à l’ennui !
Du fait de notre frénésie à recourir aux nouvelles technologies, nous allons renoncer à notre liberté, affirmait Heidegger.
Nous allons passer du statut d’Homme libre au statut de ressources. Cette analyse est encore plus pertinente aujourd’hui ; nous devenons une ressource pour des organisations comme Apple, Instagram, Google, etc. Comme le dit Humpty Dumpty à Alice dans de l’autre côté du miroir « la question est de savoir qui est le maître, et rien d’autre ». Il ne s’agit pas de se retirer du monde, nous dit Kagge, il s’agit de savoir régulièrement, éteindre son téléphone, s’asseoir et ne rien dire, fermer les yeux. Nous faisons tous partie d’un continent, mais nous ne devons jamais oublier que nous avons le potentiel pour être notre propre île déserte ajoute-t-il encore.
De nombreux Hommes se sont réfugiés dans le silence : Bouddha, Jésus, et les anciens philosophes Aristote, Platon décrivent l’expérience philosophique de l’éternel, et donc du vrai, comme étant sans mot. Le silence que nous avons dans l’esprit se trouve à l’endroit où nous nous trouvons, quand ça nous convient, à l’intérieur de notre tête, et ça ne coûte rien. Il n’est pas besoin de partir au Sri Lanka, on peut le ressentir assis dans sa baignoire souligne Kagge.
Ce dont on ne peut parler, il faut le taire fut la dernière phrase du Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Les bavardages que Wittgenstein entendait dans les salons de la bourgeoisie décadente viennoise du XX ème siècle l’ont amené à la conclusion que les conversations ineptes de ses concitoyens menaçaient le sens même de la vie.
Nous pensons qu’il avait raison, et dans le même ordre d’idée, Kagge amène cette anecdote. Tôt un matin, Claus Helberg (guide de haute montagne) guida un groupe de randonneurs au départ du gîte de Finse. L’hiver s’en allait doucement et de belles couleurs resplendissaient partout dans la nature … il commença la balade en distribuant à chacun des participants un bout de papier sur lequel était écrit Oui, c’est tout à fait fantastique.
Kagge, a souvent pensé à cette anecdote car pour lui, Helberg avait compris que les mots mettaient des limites à ce que nous ressentons. Il désirait éviter que les marcheurs passent leur temps à se dire entre eux au cours de la journée à quel point l’expérience était fantastique, au lieu de se concentrer sur ce qui était, précisément, fantastique. Les mots peuvent gâcher une atmosphère. Ils ne sont pas à la hauteur. Oui, c’est merveilleux de partage de belles aventures, mais en parler peut aussi éloigner.
Une autre question se pose alors ; est-il alors possible d’être à la fois présent au monde et absent ? Kagge pense que oui. Parfois, comme le poète William Blake, je ne parviens pas à distinguer l’éternité d’un moment :
Voir le monde en un grain de sable.
Un ciel en une fleur des champs,
Retenir l’infini dans la paume des mains
Et l’éternité dans une heure.
Kagge vit pour ce genre d’expérience, nous dit-il ; je me fais l’effet d’un pêcheur de perles qui ouvre une huître et découvre tout à coup une sphère parfaite. L’éternité, l’instant ou la joie de découvrir une perle ne se situent absolument pas dans le temps. Soudain il en est autrement. La succession ne débouche pas sur une autre, c’est plutôt comme un temps suspendu ou une succession suspendue … le temps s’immobilise.
Kagge nous montre, ici, que selon lui, il est ainsi possible de s’abstraire du monde un instant et comment un silence intérieur prend le relais. Et il souligne aussi que le silence que nous ressentons est toujours un peu différent du silence d’un autre ; chacun a son propre silence. De nombreuses personnes pensent qu’on ne doit pas laisser s’installer le silence dans une conversation alors que pour d’autres, au contraire, le silence fait partie intégrante de la conversation. Le silence apparaît aussi riche, aussi étoffé que la parole.
Ainsi, pour Kagge, les pauses agissent comme un pont ; les interlocuteurs pensent qu’ils sont sur l’une des rives du fleuve et, quand ils parlent de nouveau, ils se trouvent sur l’autre rive.
Où est le silence ; quels chemins mènent au silence ?
Ça fait du bien de s’émerveiller tout seul. Heureusement, il n’existe pas de formule magique. Pour ma part, nous dit Kagge, j’aime beaucoup marcher, mais je sais qu’il est possible de trouver le silence partout. Il s’agit de larguer les amarres ; à toi de trouver ton propre pôle Sud.
Sandrine Favre, avril 2025
Erling KAGGE, (2017). Quelques grammes de silence. Résistez aux bruits du monde ! Flammarion.