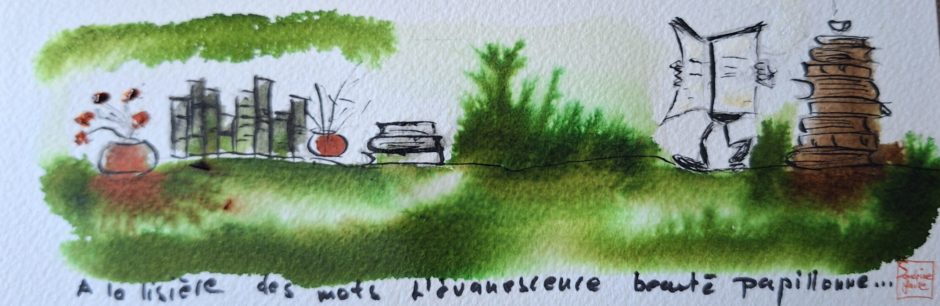Dans cet ouvrage, Elsa Godart s’interroge sur la quête de reconnaissance incessante de l’être humain et comment elle s’est visibilisée ces dernières années surtout à travers les réseaux sociaux. Elle s’inspire de Gilles Lipovetsky qui a écrit un livre de référence : L’Ere du vide.
L’ouvrage d’Elsa Godart à travers notre regard
1.- Peur de l’invisibilité.
La question première est-ce exister ou vivre ? Exister c’est se montrer, exister aux yeux des autres, être visible ; on est dans l’idée de ce que l’on pourrait être. Le regard de l’autre me confirme dans ma propre existence, donc si je n’ai pas de regard de reconnaissance, je n’existe pas.
2.- La peur de l’insignifiance
Elle nous rend fous dans la monde moderne, « rater sa vie », la manquer.
Il faut atteindre des objectifs au travail, dans sa vie, exceller dans la réussite (mais de quoi ?) et réussir aux yeux des autres.
3.- Tentative de cacher le « rien » lui -même.
Toutes ces quêtes, célébrités (télé, réseaux) reconnaissance, notoriété, cacheraient le vide de certaines vies, l’inexistence de leurs existences, leurs manques à être, déficits, manques de presque tout.
Les vies vides, mais qu’est-ce que c’est alors ?
L’autrice énonce que c’est la peur du vide qui conditionne notre rapport à la reconnaissance, exister pour mieux fuir nos vies vides, avec une perte d’espérance dans le collectif. On est convoqué par la vie, on ne peut s’y soustraire alors que l’existence est une mise en scène et même parfois une invention.
Pour ne pas répondre à la convocation de la vie et notamment à sa part de tragique (la fin de la vie entre autres), on vit d’illusions, on compose avec le réel, on se ment à soi-même.
Elle reprend la thèse de Gilles Lipovetsky qui parle du vide comme un ennui, sans densité existentielle, qui ne pousse pas à être comblé. Encore faudrait-il en avoir conscience pour avoir envie de le combler ?
Vivre est un fait et exister est une idée
Finalement c’est la différence entre exister et vivre qui est la course à la reconnaissance, pas d’existence sans reconnaissance, pas de reconnaissance sans être vu d’une manière ou d’une autre. En revanche, vivre est un fait biologique et physiologique, c’est naturel, porté par le désir (je vis, je respire, j’aime…). Je vis par l’intersubjectivité de mon lien avec les autres.
Vivre nous est donné pour vivre, croître, respirer… alors qu’exister peut se rêver, s’imaginer. On peut exister sans vivre, soit mener une vie factice.
Elsa Godart nous emmène, à travers son ouvrage, dans un voyage autour du vide.
Mais qu’est-ce que le vide ? Un espace non occupé par la matière.
Le vide dont parle Elsa Godart n’est pas tragique car il faudrait ressentir le manque, l’absence, le non-être. Or, la prise de conscience de ce vide n’est pas forcément arrivée à la conscience de ceux qui le traversent.
Le vide est un espace non occupé par des choses ou des personnes, un espace ouvert, comme un trou, c’est l’inverse de l’élan vital.
Pour mieux identifier ce vide, EG va évoquer différents champs sémantiques que je ne présenterai pas mais on peut citer la métaphysique de la nuit ou quand la lumière s’éteint – le cœur vide et le vide du cœur – le trou et le creux….
Le rien et le néant
Le non-être qui ne peut s’envisager qu’à la condition de l’être. Il est négation de quelque chose. C’est le rien. Or, le néant est une forme pleine et entière, le chaos, béance informe, abysse, gouffre, le rien.
Ce qui est le plus frappant est l’indifférence « ça ne fait rien », « ça m’est égal », « c’est sans importance : une profonde équivalence à la vérité, y être ou pas, le faire ou pas. On est dans une radicale indifférence ; tout se vaut donc rien n’a de la valeur.
Le vide serait un facteur d’anéantissement ; par contre l’élan vital ne laisse pas de place au néant. Celui-ci peut être défini sans référence à l’espace.
Culture du vide : déshumanisation, désubjectivation, elle enraie toute forme de désir.
Le rien c’est là où il n’y a plus rien à faire, plus rien à attendre, à espérer et à penser et à force de vouloir être sur la scène du théâtre social, on en oublie de vivre.
L’absence et le manque
L’absence ce n’est pas simplement le moment où l’autre n’est pas là, c’est le moment où l’absence de l’autre est vécue sous la forme d’une négativité. C’est le moment où ce qui me lie à l’autre me fait mal, même physiquement, l’absence ne fait que réveiller le manque.
L’absence révèle ce qu’il y a de plus douloureux dans le désir : le manque. L’absence s’apparente à une déchirure.
A la différence de l’attente, du manque qui s’accompagne toujours d’un espoir, l’absence c’est le vide, parfois le vide de l’autre.
Prenons le deuil qui n’est que pure douleur de l’absence sans aucune consolation de retour possible, sans l’espoir de l’attente qui peut engendrer une profonde solitude
Selon Lipovetsky, le vide est un symptôme contemporain qui produirait un « trouble narcissique » caractérisé par « un sentiment de vide intérieur et d’absurdité de la vie, une incapacité à sentir les choses et les êtres ».
Le vide émotif serait comme une anesthésie affective et sentimentale, une impossibilité à se tourner vers la plénitude de la vie intérieure.
« Partout on retrouve la solitude, le vide, la difficulté à sentir, à être transporté hors de soi » renchérit Lipovetsky. Et de préciser, qu’à l’absence et au manque ; on ne s’habitue jamais.
La vie vide
La vie vide, c’est la vie seul, sans même l’idée d’un monde en soi.
Elle le décrit comme une longue habitude d’ennui, de solitude, de lassitude. C’est l’apathie généralisée, le désintérêt, le désinvestissement, l’oubli des valeurs, telles que la vérité, la liberté, l’altérité…on se repaît de la culture du loisir et du bien-être, on consomme et on cherche à exister dans le regard des autres, ou alors en se vidant la tête ?
Nous vivons de postures, réussir des concours, gagner plus d’argent, être plus beau, moins vieux, avoir une plus grande maison, faire envie, avoir toujours plus de tout mais finalement être vide, seul ou être reconnu pour ce que l’on n’est pas.
Elsa Godart analyse les causes de ce vide :
- Vide politique : idéaux, valeurs, égalité, où sont les figures emblématiques ?
- Vide spirituel : la perte de la transcendance et du sacré, le capitalisme qui produit des frustrations, expansion du populisme et de la pensée binaire.
- Vide social : individualisme ou le vide collectif. Le déficit de l’imaginaire dans la culture des loisirs (surtourisme) ; temps à remplir obligatoirement en dehors du travail, ne pas s’ennuyer surtout, s’occuper tous ses dimanche puisqu’ils ne sont pas remplis par le travail.
- Vide éthique : La perte de transcendance et d’idéal et sa conséquence dans un lien social évidé entraîne automatiquement un vide éthique. C’est l’écart entre l’éthique pratiquée traditionnellement et l’agir moderne (insultes, injures, menaces sur les réseaux).
- Vide intime : béance du moi, comment se regarder alors qu’on est toujours soumis au regard des autres ; c’est une des dimensions tragiques de l’existence. Les injonctions de développement personnel, développer son moi avec des recettes, pas de recherche en profondeur qui ferait tout vaciller, qui demande un trop grand engagement. Même la notion d’intimité a changé : on montre tout, son corps, ses sentiments, sa chambre, ses beaux enfants, ses enfants handicapés, on expose, on s’expose. Quoi qu’on fasse on est seul, constat insupportable. La solitude est première, on est toujours seul avec soi-même, même adulé, glorifié. On ne peut sortir de soi, la solitude c’est le mal de la vie. Aristote l’avait déjà compris, on vit seul, on meurt seul, on est toujours en manque originel du regard parental « maman, regarde, regarde-moi, je suis là, j’existe ». Exister à travers le regard de l’autre car nous avons tellement de mal à vivre avec nous-même.
- Vide narcissique. Est-ce qu’on est aimé à hauteur de nos attentes ? C’est notre tragédie de vivant, une demande jamais aboutie. Jamais aucun regard, aucun j’aime, like ne suffira à combler le vide sur lequel on s’est construit. C’est la part tragique de notre existence que l’on cherche à combler en courant après les reconnaissances. Il faut donc faire semblant, sourire, rire, ignorer la tristesse. Le déni du tragique de l’homme se remarque aussi par l’absence de gravité, ignorer parfois la décence, lors des attentats par exemple, dire « j’y étais, j’ai vu… ». Mais la gravité c’est sérieux et a-t-on envie de s’infliger du sérieux ? C’est-à-dire de la droiture, se sentir concerné.
- Vide numérique : coquille vide qui produit du vide. Déni d’identité, comment avoir une identité vraie avec des pseudos ? Tout dire sans se montrer
- Vide du lien à l’autre, nommé la désintersubjectivation : c’est une indifférence, une équivalence.
Alors on peut passer d’une vie vide à une existence faussement remplie.
Si nos vies sont si banales, comment les remplir ? en s’inventant des vies avec des like, ce n’est que le passage d’une vie vide à une existence faussement remplie avec des existences aux vacances merveilleuses, aux enfants merveilleux, aux amis merveilleux…
De quoi susciter l’envie, devenir quelqu’un d’inspirant (on me copie, ne suis-je pas la plus belle ?) et même de fascinant. A ce jeu-là, comment être rassasié ?
Il faut admettre que le développement de l’existence virtuelle a donné ce goût de la notoriété. Avant il fallait avoir accompli quelque chose pour être reconnu, maintenant je peux filmer n’importe quoi à Dubaï comme les influenceurs-es, raconter une journée de courses, montrer mes nouveaux vêtements, c’est sans fin et…. sans intérêt.
Etre connu et reconnu dans l’expression de son domaine d’excellence, la recherche, l’art, la littérature… mais je peux simplement faire des courses et être reconnue, c’est facile, grisant, mais ai-je de quoi être remplie ?
De quoi créer des malaises psychiques, et l’invisibilité nous renvoie à une angoisse de mort. Où est ma différence ?
Si on admet que nommer rend vivant, il y a une logique à vouloir cette reconnaissance à tout prix, on reconnait son enfant, on le nomme.
Regarder c’est aussi faire exister ; sans le regard de mes parents, je n’existerai pas. Il faut un talent particulier pour être reconnu, or si je m’identifie à une vision médiocre de ce que je vois, ne deviendrai-je pas moi-même médiocre ?
Alors tous ces arrogants, orgueilleux, vaniteux, les égotiques gavés de leur image, prennent le risque que le principe de réalité fasse surface et qu’il ne reste rien, sinon un vide béant.
Alors comment vivre plutôt qu’exister ? On a vu que vivre est naturel alors qu’exister nécessite des efforts, se montrer.
Vivre c’est se confronter à la douleur, à la perte, aux angoisses, incertitudes, c’est aussi se confronter à soi-même, à son corps jeune, beau, mais aussi vieillissant, malade ; donc à la réalité. On veut fuir l’intranquilité, accéder à la facilité, gagner de l’argent sur du rien (Instagram, une blague ; mise en scène de ses merveilleux enfants). Le sans effort et la facilité engendrent la paresse qui nourrit la vacuité.
Alors comment lutter contre le vide ?
Etonnement, humilité et amour de la vérité.
Elsa Godart se demande si la philosophie ne devrait pas nous éviter de devenir tous des salauds.
La philosophie pratiquée dès son origine par Socrate serait une réponse aux vides existentiels et ce qui retient la vie avant tout c’est l’amour, l’amour de soi, l’amour des autres, de son travail, de sa famille.
Aimer se lever le matin ; quand je me lève, je suis vivant.
Seule la réalité de la vie nous fait grandir, il n’y a pas d’autre moyen de devenir qui l’on est.
Vivre c’est aimer mais aussi souffrir tôt ou tard, de l’abandon, de la perte, de la maladie ; c’est un effort de s’adapter, de faire face, d’admettre des émotions comme l’angoisse, la tristesse…
La vie nous met les pieds dans la glaise, elle nous terrasse, il faut faire face, se relever, se battre, il faut prendre des responsabilités mais c’est une sorte d’œuvre à accomplir alors que si on se laisse porter par l’existence, il n’y a que du vide.
Revenir à l’amour, au verbe aimer ? aimer ma vie, ce que j’en fais, c’est la pulsion de vie. Il faudrait recommencer à faire, à bâtir, à construire, donner, aimer, se retrouver ; on paresse face à l’amour.
La philosophie pourrait nous sauver par un regard qui vient interroger le monde en tout premier. Socrate « j’accepte que je ne sais pas », seul celui qui admet qu’il ne sait pas peut accueillir un savoir.
Aimer c’est donner ; philosopher c’est donner (au sens de transmettre) aussi cette vérité, cette sagesse.
Retenir l’humilité, la liberté et la simplicité au déploiement de la pensée philosophique. Commencer à faire rencontre, à créer du lien authentique.
S’engager dans l’amour, se risquer à avancer, à penser, à réfléchir, à partager, à donner. Alors qu’être vu par les autres, c’est se soumettre à l’aliénation du paraître, une sorte de mollesse de la vie.
Mais par contre, vivre c’est brasser la terre, se cogner, pleurer mais se sentir si vivant, oser le risque de vivre, accepter l’humilité de ne pas savoir.
Vivre finalement demande du courage.
Quelques questionnements
Tout le monde n’est pas concerné par la problématique énoncée par Elsa Godart, des histoires de génération. Le besoin de reconnaissance peut sans doute être recherché et assouvi de différentes façons sans avoir recours aux réseaux. C’est une évidence.
Ses références nombreuses philosophiques ont enrichi cet essai avec une profondeur d’analyse, cependant il a fallu faire des choix dans le texte ci-dessus.
Ce chemin autour du vide, du néant est un nouveau questionnement résolument post-moderne et l’approche philosophique qui en est faite permet un regard et des réponses approfondies.
L’idée de vivre nous ramène à notre chair d’humain, relié aux autres, nous ancre dans une réalité bien plus profonde que le virtuel.
Et Elsa Godart a assurément un talent d’analyse approfondie qui m’a enthousiasmée par les aspects positifs de sa pensée.
En offrant cette approche qui nous raconte aussi l’espoir et la possibilité d’autre chose…
Yolande Meynet, avril 2025
Faire le pari de la vie sur l’existence selon Victor Hugo :
« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front,
Ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime,
Ceux qui marchent pensifs, épris d’un but sublime,
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C’est le prophète saint prosterné devant l’arche,
C’est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche ;
Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins,
Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre.
Inutiles, épars, ils traînent ici-bas
Le sombre accablement d’être en ne pensant pas.
Ils s’appellent vulgus, plebs, la tourbe, la foule.
Ils sont ce qui murmure, applaudit, siffle, coule,
Bat des mains, foule aux pieds, bâille, dit oui, dit non,
N’a jamais de figure et n’a jamais de nom [ … ] »
(Victor Hugo, Œuvres complètes, Gallimard, 1964, p. 206)
Godart, Elsa, (2023), Les vies vides : notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier. Armand Colin.